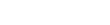Il y a de la discrimination et du racisme dans l’accès à l’emploi, dans le monde du travail, dans l’éducation, dans l’accès au logement, dans la santé, au niveau de la justice et de la police… « Les gens de couleurs » sont dénigrés et humiliés par les média, les hommes politiques et les représentants de l’état. Et que fait-on dans le HipHop ? Que dit-on dans le HipHop ? Qu’il faut (continuer de) accuser et se focaliser sur les extrémistes et l’extrême droite? Non… parce que le combat est ailleurs. Le combat, il est dans la responsabilité individuelle et sociale, ainsi que dans la nécessité de faire un effort de mémoire. Ce combat, le sociologue Said Bouamama, et le MAI le mènent au quotidien. Ce combat, le HipHop se doit aussi de le mener. Explications avec M. Bouamama.
Il y a environ 20 ans (1983) votre combat, c’était en quelque sorte, celui de la reconnaissance de votre existence dans le pays (j’y suis, j’y reste.. donc il faut faire avec moi). Que s’est-il donc passé en octobre 1983 ? Comment et pourquoi est né ce mouvement ?
Cette période est celle des crimes et agressions racistes dans un contexte politique où le Front National fait ses premières percées électorales, où ses thèmes commencent à se répandre dans l’ensemble de la classe politique et où le PS l’instrumentalise et le favorise pour diviser la droite. La marche pour l’égalité (et non la marche des Beurs comme l’on appelait les médias) était une révolte pour le droit à la vie. Le slogan de la marche était « Rengainez vos fusils les marcheurs sont arrivés ».
Au cours de la marche, le mouvement se conscientise et affine ses analyses et prises de position. Il réagit contre les tentatives de récupération qui se font jour et qui veulent limiter nos revendications à un anti-racisme abstrait et « fraternel » (ce que sera SOS racisme un an après) sans revendications précises et en oubliant notre révolte initiales pour l’égalité. L’année d’après, une seconde marche « Convergence 84 » s’adresse à l’opinion publique pour appeler à la convergence de tous les dominés, en rompant avec le paternalisme et le fraternalisme de l’antiracisme abstrait.
La radicalisation du mouvement poussera le PS à lancer médiatiquement SOS qui n’a jamais eu d’ancrage dans les quartiers populaires. L’objectif était clair : contrecarrer le développement d’un mouvement autonome radical. A nos revendications (droit de vote pour les parents, lutte contre les discriminations, interdiction de la vente libre d’armes, etc.), SOS oppose ses slogans vides « touche pas à mon pote », « j’aime qui je veux », etc.
Avec le recul, quel a été l’impact de ce mouvement ?
Ce mouvement a permis l’apparition publique des jeunes issus de la colonisation dont l’existence même était niée auparavant. Il a permis d’imposer un certain nombre de débat à la société française et à sa classe politique. Désormais personne ne peut plus nier le scandale d’une inégalité massive dans la société et dans les institutions (école, police, services publics) à partir du critère des origines. Par contre, le mouvement n’a pas pu se structurer durablement de manière autonome afin de construire un rapport de force permettant de transformer la réalité. Les discriminations se sont amplifiées et une nouvelle catégorie de sous-prolétaires issue de la colonisation s’est mise en place.
Le HipHop a commencé à émerger, coïncidence après la marche pour l’égalité. Le HipHop, à la base, c’est la rébellion contre le status quo. Et la jeunesse immigrée est fortement impliquée dans le HipHop. Mais il y a eu rendez-vous manqué. A priori, il y avait un lien entre la marche pour l’égalité et le HipHop. Mais le rendez-vous a été manqué. Pourquoi selon vous ?
Le lien est à mon avis évident. La marche comme le HipHop sont deux expressions d’une même révolte contre la domination. Dans les deux cas, ce qui est dénoncé c’est le scandale d’une vie d’esclave faite à toute une partie de la jeunesse des milieux populaires. Ce qui est décrit comme aspiration, c’est dans les deux cas, une exigence de vérité et d’égalité. Le rendez vous a été manqué du fait de la jeunesse du mouvement HipHop à cette époque. L’inexpérience militante des marcheurs explique aussi cette non rencontre. Ceci dit le combat continue et j’espère que le HipHop sera présent au prochain grand rendez vous national, « les assises de l’anticolonialisme » qui fait suite à l’appel « Les indigènes de la République » et qui se déroulera le 16 avril prochain à Paris.
Chinua Achebe, un écrivain nigérian a dit ceci : « L’histoire est notre escorte. Sans elle, nous sommes aveugles ». Vous insistez sur l’importance de l’histoire, notamment celle de l’immigration en France. Quelle est l’importance de l’histoire, de la nécessité de connaître son histoire surtout pour les jeunes aujourd’hui?
Toutes les dominations se construisent par des occultations de l’histoire. Il existe une histoire de l’exploitation de nos parents, une histoire de leurs révoltes et de leurs luttes, une histoire de l’esclavage et de la colonisation qui a permis le développement économique de la France et qui a plongé les pays d’Afrique dans la misère, etc. Sans prendre en compte cette histoire, on se contraint à des prises de conscience partielle, à se tromper parfois de combat, à être récupérés et instrumentalisés, à refaire toujours les mêmes erreurs.
Le racisme n’est pas un aspect moral de quelques mauvaises personnes. Il fait partie de l’histoire économique et politique de ce pays. Il est intériorisé dans les inconscients politiques et les imaginaires collectifs. Prendre la mesure du combat à mener suppose une connaissance de ces histoires et de ces luttes.
Comment transmettre l’histoire lorsqu’elle n’est pas racontée dans les livres d’école et ignorée dans les grands média ?
L’histoire transmise est toujours celle des dominants. Il y a toujours eu des luttes autour de la manière de dire l’histoire. Comme pour les autres questions, ce sont les rapports de force qui contraignent les dominants à intégrer dans les médias, les livres scolaires, etc. des pages noires jusque là occultées. Faire parler cette histoire enfouie par tous les moyens (manifestation publique, chansons, livres, etc.) est une première étape. Construire un rapport de force pour contraindre à la prise en compte est une seconde étape.
Beaucoup de gens sont dans l’illusion aujourd’hui. Beaucoup de gens pensent que le combat est fini. Les gens pensent que parce qu’on voit des noirs et des arabes à la télé, au journal TV, dans les grandes émissions, parce qu’on voit tel ou telle en couverture d’un grand magazine ou à un poste de cadre dans une grande entreprise, qu’il n’y a plus de combat. C’est vraiment dangereux parce que cette illusion est en fin de compte une arme qui nous maintient dans notre situation et nous empêche à aspirer à mieux. C’est en partie à cause de cette illusion que beaucoup de gens ne voient pas l’urgence et ne se réunissent pas pour agir… ensemble. Comment expliquez-vous cette illusion ?
L’émergence d’une minorité que l’on met en scène vise à masquer que l’essentiel des enfants de l’immigration est contraint à une vie de parias. Les chiffres parlent d’eux mêmes : ils sont surreprésentés dans les prisons, les décès du SIDA, le chômage, les emplois précaires sans avenir, les contrats aidés, l’échec scolaire, etc. En réalité, la société française s’enfonce dans le modèle américain avec une couche moyenne minoritaire et une masse d’esclave moderne. C’est la vieille politique coloniale consistant à faire émerger une « élite indigène » masquant le scandale de la vie des autres. L’illusion provient d’une analyse et d’une conscience politique insuffisante qui continue à analyser le racisme comme étant d’abord moral et d’oublier que ce racisme a une fonction économique : assigner certains à une place de dominés et leur faire intégrer une mentalité de dominés comme à l’époque coloniale. L’illusion provient aussi de la faiblesse de nos associations comme organisation du combat commun. Beaucoup d’associations se sont enfermées dans la gestion d’activité (avec subventions et salariés) alors qu’elles devraient être des organisateurs des revendications.
Comment rompre avec cette illusion ?
La rupture avec cette illusion passe par la conscientisation, la formation politique, la connaissance des luttes de nos prédécesseurs, le refus de la compromission, etc. Bref un long chemin reste à parcourir, mais il est le seul possible pour que dans cent ans, nos petits enfants ne soient pas encore assignés à une place de dominé.
Vous avez un discours qui peut être considéré comme radical par les temps qui courent… Je suppose que c’est quelque chose que vous avez certainement dû entendre. Qui dit «radical ou trop radical » dit, généralement, peu de soutien de la part de la majorité des gens, de la communauté immigrée dans le cas présent. Que répondez-vous à ceux qui pensent ou disent que vous êtes est trop radical ?
Etre radical, c’est poser les choses à leurs racines et refuser sous prétexte de « réalisme » de farder la gravité de la situation. Faut-il également rappeler que tous les progrès en termes de droits ont été obtenus parce que des militants ont acceptés de décrire la réalité telle qu’elle est ? Nous ne choisissons pas la radicalité, c’est la réalité sociale qui est radicalement inégalitaire. Dans le passé, on a taxé de radicaux ceux qui exigeaient la fin de l’esclavage puis de la colonisation. De même, on a taxé de radicaux ceux qui exigeaient que les immigrés aient les mêmes droits que les français. Les radicaux d’hier nous permettent d’avoir nos libertés et droits d’aujourd’hui. Les radicaux d’aujourd’hui préparent des acquis qui seront considérés comme non radicaux à l’avenir. Et puis quel est l’autre chemin, celui des « non radicaux » ? Demander aux victimes de patienter, dire que la réalité est grave mais qu’on ne peut rien faire, farder la réalité pour qu’elle n’apparaisse pas comme radicale ?
Vous faites partie d’une association appelée MAI. Comment définiriez-vous votre mission ? en quoi consiste vos actions ?
Le MAI porte ses objectifs dans son titre : Mouvement Autonome de l’Immigration. Il a trois domaines d’intervention : Agir pour la défense des intérêts de l’immigration et de ses enfants français ; Trouver les ponts et alliances pour contribuer aux combats sociaux français avec d’autres dominés ; Soutenir le combat des pays d’origine contre la main mise des puissances occidentales qui continuent de piller les richesses et de déclencher des guerres pour s’accaparer celles-ci. Nos actions sont donc multiples (pétitions, manifestations publiques, accompagnement juridique devant des discriminations, etc.) et nous tentons de contribuer à un mouvement national des immigrations et des quartiers populaires.
Comment expliquez-vous ce peu de lien, de collaboration durable et permanente entre les associations de votre genre et le milieu HipHop ?
Cette faiblesse est liée à une incompréhension de ce qui devrait nous unir : la révolte commune contre les inégalités. Le reste n’est que partage du travail, chacun agissant avec ses outils. Je pense aussi que le mouvement militant a sous-estimé l’apport des artistes au combat et qu’à l’inverse ces artistes ont voulut préserver une « liberté ». N’oublions pas que la liberté, c’est agir sur ce qui est nécessaire à l’époque que l’on vit. Le reste, c’est l’idéologie de la liberté que véhicule les médias : l’artiste qui pense seul et qui regarde « son moi intérieur ». L’art et la manif sont deux formes d’expression d’une même révolte. Elles doivent converger et se mettre au service des combats réels.
Pourquoi à votre avis, les rappeurs (issus de l’immigration) ne sont pas davantage engagés politiquement, ne serait-ce que dans leurs textes ?
Les rappeurs comme les militants sont partagés entre deux tendances contradictoires : leur engagement et le souci individuel de sortir de la précarité. Tant qu’ils ne seront articulés à un mouvement organisé, la volonté de sortir de la galère se fera au détriment des raisons de l’engagement. Cette réalité est dure à constater mais est bien réelle. Les récupérations se font toujours en s’appuyant sur la galère réelle des personnes. La seule garantie est de se penser comme outil chanté ou dansé des luttes et non comme « artistes » cherchant une reconnaissance ( par qui ? et à quel prix ? )
—————————
Said Bouamama est écrivain, sociologue et militant associatif au sein du MAI (Mouvement Autonome pour l’Immigration). Il est notamment l’auteur de L’affaire du voile, la construction d’un racisme respectable (éditions du Geai Bleu) et De la galère à la citoyenneté (Desclée de Brouwer, 1997) entre autres.